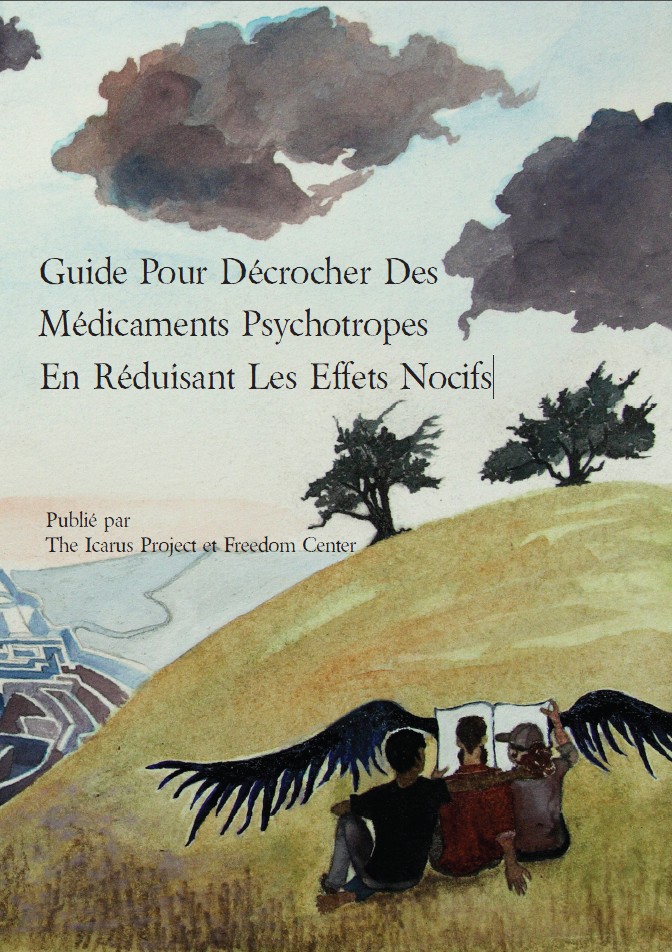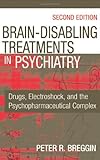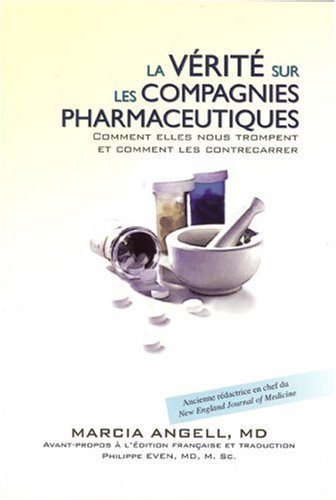La marchandisation de la dépression (II). Médicalisation des humeurs, invention de nouveaux troubles, emprise financière de l’industrie sur la recherche et les soins…
Cette partie du texte de Janet Currie, La marchandisation de la dépression, illustre parfaitement les méthodes de l’industrie pharmaceutique : invention de nouvelles maladies ou redéfinition des anciennes pour englober plus de monde (disease mongering), des stratégies publicitaires qui médicalisent des aspects physiologiques ou des émotions justifiées et temporaires, des « tests » de dépistage à questions très floues et vagues pour que tout le monde se sente concerné… L’industrie pharmaceutique finance les associations de patients et les groupes d’entraide existants ou en crée d’autres pour les instrumentaliser dans la promotion de tel médicament. 85% des dépenses promotionnelles concernent les financements et autres cadeaux faits aux médecins, au moyen de la visite médicale, des voyages, cadeaux, rémunérations pour activités publicitaires, financements de leurs recherches… Enfin, les autorités sanitaires ne font rien pour limiter ces dérapages extrêmes et pour que médecins et patients aient une information médicale transparente. Elles devraient exiger que tous les résultats des essais cliniques et des recherches soient publiés, et pas seulement ceux positifs. Réglementer les campagnes « d’information » sur les maladies (qui sont en fait de la pub), assurer une information des médecins par des moyens autres que la visite médicale payée par les firmes, etc. Les agences du médicament devraient exiger une bonne information sur les risques et effets secondaires et réagir au moindre problème. Or seul 1% des médecins signalent des effets indésirables…
[La dépression assimilée à la tristesse. Définition tellement large qu’elle englobe tout]
« [Les firmes pharmaceutiques] ont aussi adopté des stratégies visant à élargir la définition de « dépression », qui englobe désormais toutes les formes de dysphorie (tristesse). Ceci permet aux fabricants de promouvoir l’utilisation des ISRS pour soigner une gamme de nouveaux « troubles » qu’ils ont suggérés ou définis.
Edward Shorter, professeur en histoire de la médecine et auteur de A History of Psychiatry, affirme qu’il y a eu un « élargissement constant » de la définition de dépression. On connaissait depuis longtemps la dépression majeure réfractaire (diagnostic généralement réservé à des patients hospitalisés pour de longues périodes). À la fin des années 1960, la communauté psychiatrique a modifié la définition de la dépression « l’assimilant à la dysphorie (mot qui signifie tristesse) assortie d’une perte d’appétit et de troubles du sommeil62 ». Selon Arthur Kleinman, professeur de psychiatrie à Harvard et coauteur de Culture and Depression, « Une dépression clinique grave est une maladie, j’en suis persuadé. Mais, une dépression légère, c’est un diagnostic “fourre-tout” qui nous permet de classer plein de choses 63 ».
Kathryn Schultz explique, dans un reportage paru dans le New York Times, comment les [firmes] pharmaceutiques ont réussi, en quelques années, à convaincre la société japonaise qu’elle devait redéfinir ses notions en matière de santé et de maladie. Elle précise que l’expression dépression légère n’existait pas dans la langue japonaise… jusqu’en 1999. Cette année-là, la compagnie Meiji Seika Kaisha a commencé à promouvoir le Depromel (un ISRS). Selon le psychiatre japonais Tooru Takahashi, la mélancolie, la sensibilité et la fragilité n’étaient pas perçus comme des sentiments négatifs au Japon. « Pourquoi aurions-nous cherché à soigner quelque chose qui ne nous semblait pas mauvais au départ? »
Comme la publicité directe de médicaments d’ordonnance est bannie au Japon, les pharmaceutiques ont mené d’intenses « campagnes de sensibilisation populaire » au sujet du kokoro no kaze, ce nouveau « trouble de santé » très répandu. Les représentants des pharmaceutiques effectuaient en moyenne deux visites hebdomadaires aux cabinets des médecins, moussant la prescription des ISRS pour des symptômes tels que « tête lourde, tension aux épaules, troubles du sommeil, maux de dos, fatigue, paresse et manque d’appétit ». Selon le responsable de la commercialisation du Paxil [Deroxat / Seroxat] : « Les Japonais ignoraient qu’ils souffraient de cette maladie. Aussi avons-nous jugé important de leur en parler, de leur expliquer que la médecine peut venir à bout de la dépression ». En cinq ans, les profits générés par la vente des ISRS au Japon ont atteint des sommets vertigineux. Entre 1998 et 2003, les ventes d’ISRS ont quintuplé. La société GlaxoSmithKline, qui fabrique le Paxil, a dégagé des profits de 298 millions de dollars US en 2003, une hausse par rapport à 2001 où ils atteignaient 108 millions.
Selon Arthur Kleinman, l’exemple japonais est très inquiétant. La capacité des grandes entreprises à « médicaliser les humeurs » est l’une des retombées les plus graves de la mondialisation. Et le Japon a été le premier pays à le découvrir64.
[Le dépistage au moyen de tests douteux, donnant beaucoup de faux positifs]
On emploie diverses méthodes afin d’élargir la définition de dépression, dont des instruments rudimentaires pour dépister la dépression, voire la diagnostiquer. On obtient ainsi un taux élevé de prévalence des cas de dépression, statistique dont se servent les pharmaceutiques pour prouver au public, aux prestataires de soins et aux bailleurs de fonds que la dépression est un trouble répandu au sein de la population et que son traitement laisse beaucoup à désirer.
Certains outils de diagnostic – le Prime-MD (mis au point grâce au soutien financier de Pfizer, une société pharmaceutique) et le SPHERE (outil comportant 12 questions et subventionné par Bristol-Myers-Squibb), par exemple – sont très prisés par nombre d’établissements de santé, petits et grands. Ils font aussi l’objet d’une promotion vigoureuse, en particulier lors des campagnes « d’information » commanditées par les pharmaceutiques. Enfin, ils sont très populaires auprès des organismes en santé mentale et des groupes de patients.
Les médecins de famille (les plus grands prescripteurs d’ISRS) sont un élément vital de cette expansion. Le concepteur du questionnaire SPHERE, qui a bénéficié du soutien financer de l’industrie pharmaceutique, recommande que le dépistage des maladies mentales, telles que la dépression, soit un élément de chaque consultation médicale, quel que soit le motif de la visite, et ce, même si le patient ne présente aucun symptôme. Dans un cas où le médecin a administré le questionnaire SPHERE, six patients sur dix ont reçu un diagnostic de trouble mental; pourtant leur visite n’était pas motivée par un problème psychologique65. Comme la plupart des omnipraticiens jugent qu’il est difficile d’intégrer le dépistage de la dépression, par la recherche de cas ou les questionnaires, à leurs tâches habituelles, Arroll leur recommande d’administrer un prétest, qui comporte deux questions66 :
- Au cours des 30 derniers jours, vous êtes-vous senti souvent abattu, déprimé, désespéré?
- Au cours des 30 derniers jours, avez-vous souvent trouvé que les activités habituelles exigeaient un effort et devenaient pesantes et pénible?
Le dépistage de la dépression est une activité répandue au sein des établissements de santé qui sont la cible des pharmaceutiques. L’échelle de dépression postnatale d’Édimbourg (Edinburgh Postnatal Depression Scale, EPDS) sert à évaluer les femmes qui viennent d’accoucher. Ce test repose sur l’hypothèse suivante : bien des femmes souffrent de dépression postnatale et, sans dépistage, elles continueront d’en souffrir. Oates souligne que l’EPDS produit entre 30 % et 70 % de faux positifs. L’auteur ajoute que, lorsqu’il est bien administré, cet instrument permet en effet de dépister les cas de dépression mineure, que l’on pourrait traiter par des rencontres supplémentaires avec un prestataire de soins. Mais, en raison de la pénurie de ressources et de compétences, bien des femmes qui souffrent de dépression postnatale reçoivent des antidépresseurs plutôt qu’un traitement non médicamenteux67.
On a instauré, au Canada et aux États-Unis, des journées de dépistage de la dépression, au cours desquelles divers organismes (centres de santé mentale, gouvernement, etc.) offrent aux personnes intéressées un test de dépistage. Cette journée est subventionnée par les sociétés Elli Lilly, Forest Laboratories, GlaxoSmithKline, Pfizer Inc. et Wyeth. Selon Edward Shorter, les « records de dépression » enregistrés chaque année aux États-Unis lors de ces journées font jubiler l’American Psychiatric Association68.
D’autres initiatives du même genre, on pense notamment à la Semaine de la santé mentale et à la Semaine de prévention du suicide, sont aussi l’occasion pour les pharmaceutiques, ou les porteparole de leurs groupes de patients, de faire passer leurs messages : la dépression est une maladie très répandue et son traitement laisse beaucoup à désirer.
Les pharmaceutiques ciblent également des groupes vulnérables et les professionnels de la santé. Wyeth, par exemple, commandite des forums dans les universités états-uniennes intitulés « Depression in College: Real World and Real Issues ». Lors de ces forums, des médecins, des psychologues et des vedettes reprennent les messages véhiculés par les fabricants69.
Le dépistage à grande échelle et obligatoire est une tendance qui prend des proportions inquiétantes. Ainsi, la New Freedom Commission on Mental Health, instance que vient de créer le président George W. Bush, a recommandé que toute la population des États-Unis soit soumise à un dépistage des « maladies mentales ». Ce test se déroulerait à l’école et au cabinet du médecin. Comme le fait remarquer Sheldon Richman, si cette recommandation est adoptée, nul ne sera à l’abri des questions indiscrètes des « experts » soutenus par des sociétés pharmaceutiques qui sont persuadées que l’on sous-diagnostique gravement le nombre de personnes souffrant de maladies mentales et que des millions de personnes devraient suivre un traitement à base de médicaments d’ordonnance puissants et coûteux70. (…)
Exagération des risques [facteur de disease mongering ou façonnage de maladies]
Les pharmaceutiques ne se contentent pas d’affirmer que la dépression est largement répandue au sein de la population et que le traitement de ce problème de santé laisse cruellement à désirer. Elles défendent aussi très activement le message suivant : ne pas traiter la dépression est très onéreux pour la société.
Pour étayer leurs affirmations sur la gravité de la dépression, les fabricants de médicaments reprennent une statistique selon laquelle 15 % des personnes dépressives risquent de se suicider (600 par 100 000 années-patients). Cette statistique laisse entendre que toute personne qui se sent déprimée et qui n’est pas traitée (à l’aide d’ISRS, par exemple) est à risque. Or, comme le souligne David Healy71, ce risque de suicide à vie provient d’une métaanalyse effectuée en 1970 et publiée dans le British Journal of Psychiatry, qui faisait le point sur les études menées en Allemagne et en Scandinavie auprès de patients hospitalisés souffrant d’une dépression majeure chronique et d’un trouble bipolaire. Il est également possible que certains de ces patients aient été traités avec les médicaments à risques élevés qui étaient en vogue à l’époque en psychiatrie.
En réalité, comme le démontrent les études sur les soins primaires aux personnes dépressives, le taux de suicide varie entre 0 et 68 suicides par 100 000 années-personnes, et ce, pour tous les troubles de l’humeur. Comme le fait remarquer Charles Medawar, si le taux de suicide était aussi élevé que le prétendent les pharmaceutiques, il y aurait un suicide par semaine parmi les patients de chaque médecin de famille exerçant au Royaume-Uni72.
En plus d’exagérer le risque de suicide chez les personnes dépressives non hospitalisées, les pharmaceutiques soutiennent qu’il est extrêmement onéreux pour la société de ne pas traiter tous les cas de dépression. Aux États-Unis, par exemple, PhRMA (l’organisme représentant l’industrie pharmaceutique) et l’American Psychiatric Association ont mis au point une formule permettant aux employeurs de calculer le taux de prévalence de la dépression en milieu de travail et les avantages financiers que rapporte le traitement de cette maladie73.
Inventer de nouveaux troubles [Disease mongering ou façonnage de maladies]
Afin d’augmenter leur part du marché et de maximiser leurs profits, les pharmaceutiques ne cessent d’élargir les champs notionnels de la dépression et de l’anxiété en y greffant de « nouveaux troubles », tels que le trouble d’anxiété sociale, le trouble panique, le trouble dysphorique prémenstruel et le trouble d’anxiété généralisée. Elles peuvent alors faire prolonger la protection conférée par un brevet (c.-à-d., le droit exclusif d’exploitation d’un médicament donné pendant une période donnée) à certains ISRS. La prolongation du brevet se traduit par d’énormes profits pour les pharmaceutiques. Charles Medawar rapporte que la protection par brevet du Paxil [Deroxat/ Seroxat], l’ISRS fabriqué par la société GlaxoSmithKline, a été prolongée aux Etats-Unis à cinq reprises entre 1998 et 2001. Le résultat : la société a pu exploiter cette marque pendant au moins cinq années de plus et a réalisé des profits d’un milliard de dollars par année74.
Lorsque la part du marché qu’occupe un ISRS commence à diminuer, les pharmaceutiques ont recours aux nouveaux troubles afin de le « repositionner ». La société GlaxoSmithKline, par exemple, a dû repositionner le Paxil lorsqu’un autre ISRS, le Zoloft, est arrivé sur le marché. Désormais, le Paxil [Deroxat / Seroxat] serait utilisé dans le traitement du trouble d’anxiété sociale et du trouble obsessionnel-compulsif. Par suite d’une campagne de promotion musclée, le trouble d’anxiété sociale s’est classé soudainement au troisième rang des maladies mentales les plus courantes aux États-Unis. Cette initiative, qui était menée par une coalition de groupes sans but lucratifreprésentant des patients et des professionnels, avait été organisée par la firme de relations publiques de GlaxoSmithKline. Selon docteure Marcia Angell, ancienne rédactrice en chef du New England Journal of Medicine et auteure de The Truth about the Drug Companies, la personne chargée du marketing du Paxil à l’époque aurait déclaré : « Le rêve de tout spécialiste en commercialisation? Découvrir un marché inconnu et l’exploiter. Et c’est exactement ce que nous avons fait avec le trouble d’anxiété sociale »75.
Brendan Koerner, auteur et journaliste au Guardian, décrit la stratégie de marchandisation de la maladie adoptée par les pharmaceutiques. Une stratégie qui pourrait avoir été conçue « par une machine » selon Loren Mosher, psychiatre et ancien cadre au National Institute of Health.
- On met en évidence une affection mineure dont pourrait souffrir un grand nombre de personnes (le trouble dysphorique prémenstruel ou le trouble d’anxiété généralisée, par ex.).
- Les pharmaceutiques financent des recherches qui démontrent l’efficacité du médicament.
- Sur la foi d’un petit nombre d’essais cliniques, la FDA autorise la mise en marché du médicament, qui a été testé uniquement contre des placebos.
- Dans des articles pour la presse grand public ou la presse scientifique, des médecins éminents (souvent rémunérés par des pharmaceutiques) mettent en évidence la gravité et la prévalence de l’affection.
- On minimise les effets indésirables du médicament, ou on ne les mentionne pas, dans les annonces publicitaire ou dans les rapports de recherche.
- Les résultats négatifs des essais cliniques ne sont ni publiés ni diffusés.
- On confie la promotion du médicament dans les médias à de firmes de relations publiques. Pour démontrer l’efficacité du médicament, on cite des statistiques provenant d’études commanditées par le secteur privé.
- Afin de donner un « visage humain » à cette nouvelle affection, on crée et on finance un regroupement de personnes qui en souffrent. Leurs témoignages et leurs commentaires seront largement diffusés dans les médias76.
[Le DSM dans le disease mongering et l’élargissement de la définition de la dépression]
Le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (DSM), l’ouvrage qui définit et décrit les troubles mentaux, a également contribué à élargir le concept de dépression. Le DSM est utilisé à l’échelle mondiale et a toujours reflété, depuis la première édition, les croyances et les valeurs dominantes de l’époque. Le comité éditorial du DSM-I, paru en 1952, était dominé par les psychanalystes. En 1973, année de parution du DSM-III, ce comité regroupait des psychiatres qui défendaient la théorie selon laquelle les problèmes de santé mentale sont d’origine biologique ou pharmacologique plutôt qu’affective ou situationnelle. Depuis lors, le nombre de troubles mentaux étiquetés a crû rapidement : de 106 dans le DSM-I, il est passé à plus de 350 dans le DSM-IV77.
Et les pharmaceutiques ont contribué à ce processus. En voici un exemple, cité par Paula Caplan, psychologue et auteure de plusieurs ouvrages sur le DSM et les méthodes servant à définir les troubles mentaux. Vers la fin des années 80, les auteurs du DSM ont inventé de toutes pièces un trouble mental : le trouble dysphorique prémenstruel (TDPM), et ce, malgré l’absence de preuves empiriques attestant que ce « trouble » existe réellement. On recommanda d’emblée un seul traitement : un ISRS, le Prozac habituellement. Pourtant, il existe d’autres moyens de soulager les douleurs prémenstruelles, dont les suppléments de calcium, l’exercice ou les groupes de soutien. En juin 1999, alors que le brevet pour le Prozac venait à échéance, la société Eli Lilly a réuni des experts aux États-Unis afin d’obtenir l’homologation du TDPM, ce qui lui permettrait de prolonger le brevet pour le Prozac sous un nouveau nom (Serafem). Selon Mme Caplan, la mise au point du Serafem a prolongé de sept ans le cycle de vie du Prozac et a permis au fabricant d’empocher des millions de dollars78, car le Serafem, bien qu’identique au Prozac, était vendu plus cher.
La promotion des ISRS auprès des médecins [visite médicale, congrès, presse financée, etc.]
Les sommes consacrées par l’industrie pharmaceutique au marketing et à l’administration sont 2,5 fois supérieures à celles destinées à la recherche-développement. Et l’écart ne cesse de s’agrandir. Entre 1995 et 2000, le nombre d’employés affectés à la commercialisation dans les pharmaceutiques états-uniennes a augmenté de 60 % alors que le secteur de la recherche a perdu 29 % de son effectif79.
Les activités de promotion auprès des médecins représentent 85 % de l’ensemble des dépenses engagées par les pharmaceutiques en matière d’activités promotionnelles. Ces activités englobent les rencontres avec les médecins (cabinets et milieu hospitalier), la distribution d’échantillons gratuits et la parution d’annonces publicitaires dans les revues médicales. Entre 1996 et 2000, on a observé une hausse de 58 % dans ce secteur d’activité80. On estime que, chaque année, aux États-Unis, les pharmaceutiques consacrent 25 000 $ par médecin à la promotion de leurs produits. Il n’y a pas de données comparables pour le Canada81.
La distribution d’échantillons gratuits aux médecins et aux hôpitaux contribue à la surutilisation des ISRS. En 2003, le coût de ces échantillons se chiffrait à 16,3 milliards de dollars aux États-Unis. À ceci s’ajoutaient 4 milliards pour les visites effectués par les représentants commerciaux82. Le docteur Ashley Wazana, psychiatre et chercheur, est l’auteur d’une recension des recherches portant sur les interactions entre les médecins et les représentants des pharmaceutiques. Il conclut que « si le médecin accepte un échantillon, il est plus porté à bien connaître, voire préférer, un médicament, à prescrire sans hésiter un nouveau médicament et à avoir une attitude favorable à l’égard des représentants pharmaceutiques83 ».
Selon le docteur David Healy, les congrès médicaux, dont ceux de l’American Psychiatric Association, se sont transformés en « cirques » promotionnels et commerciaux. Désormais, les services de limousine, l’hébergement dans des hôtels de luxe, les repas, les réunions de tous les comités, les activités sociales, les publications, les « conférences spéciales » et les échantillons sont offerts gracieusement par l’industrie pharmaceutique. Les colloques organisés en marge de l’événement principal par les pharmaceutiques sont aussi fort populaires. Des conférenciers rémunérés par l’industrie profitent de ces tribunes pour mousser sans réserves leurs propres médicaments. Comme bon nombre de ces séances sont largement commentées dans les revues médicales, cela donne un portrait faussé exagérant le nombre d’essais cliniques et de résultats positifs84.
La publicité dans les revues médicales renforce les messages communiqués antérieurement par les représentants commerciaux. Ainsi, Munce et al. révèlent, dans leur recension des revues des associations canadienne, états-unienne et britannique de psychiatrie, que 57 % des publicités sur des psychotropes mettent en vedette des femmes; que 67 % des annonces ciblant les 20 à 40 ans sont destinées aux femmes, tout comme la majorité (90 %) des annonces ciblant les personnes âgées (81 ans et plus)85. Les auteurs soulignent aussi que bon nombre de ces annonces sont trompeuses ou peu réalistes. En outre, toutes les annonces véhiculent, à l’aide d’une échelle des émotions (des plus négatives aux très positives), le message suivant : prendre le médicament entraîne une nette amélioration de la santé mentale. Ce genre de publicité minimise la possibilité d’un échec du traitement médicamenteux et les effets indésirables du médicament.
Les médecins se fondent beaucoup sur les guides de pratique clinique (GPC) dans leur exercice quotidien. Les GPC offrent aux médecins une synthèse des résultats d’essais cliniques et des recommandations de spécialistes sur le traitement de diverses affections, dont la dépression. Ces guides sont publiés et diffusés sur une grande échelle, ce qui en fait la « bible » d’un grand nombre de médecins. Choudry et al. ont constaté, après avoir étudié des GPC européens et nordaméricains sur le traitement de diverses maladies, dont la dépression, que 87 % des auteurs avaient eu des rapports de quelque sorte avec l’industrie pharmaceutique. Dans environ 60 % des cas, il s’agissait de rapports avec des sociétés dont les médicaments étaient mentionnés dans les guides. Choudry ajoute que, dans la majorité des cas, les auteurs n’avaient pas inclus de mise en garde sur la possibilité de conflit d’intérêts 86; son étude toutefois n’explore pas les répercussions que pourrait avoir le parti pris des auteurs sur le contenu des GPC.
Les soins et leur financement : des changements qui font réfléchir
Au Canada, un nombre élevé de personnes n’ont plus de médecin de famille ou se tournent vers les urgences ou les cliniques sans rendez-vous lorsqu’elles ont besoin de soins médicaux. Il s’agit, dans bien des cas, de soins de courte durée prodigués de manière impersonnelle. Par ailleurs, les omnipraticiens [médecins généralistes], qui prescrivent 81 % des ISRS, ont parfois une très lourde charge de travail et n’ont pas toujours le temps d’écouter leurs patients. Pour certains d’entre eux, les ISRS représentent donc une solution rapide aux difficultés que certains événements de la vie suscitent chez leurs patients (deuil, ménopause, stress lié au travail, retraite ou problèmes conjugaux).
Ajoutons à ceci que, s’il y a dépassement des montants prévus pour les services psychologiques, la plupart des régimes d’assurance médicaments ou d’assurance maladie, ne prendront pas nécessairement en charge l’excédent. Ils couvrent toutefois les consultations médicales qui se terminent, en général, par la proposition de médicaments contre la dépression. Selon des recherches menées aux États-Unis, la psychiatrie suit aussi la même tendance. Olfson a constaté qu’entre 1985 et 1995 la durée des séances chez le psychiatre avait diminué, que les séances étaient moins souvent de nature psychothérapeutique et que le psychiatre remettait plus souvent une ordonnance pour un médicament. Le nombre de consultations durant moins de 10 minutes avait augmenté87. On ignore si cette tendance a cours au Canada.
La promotion des ISRS directement aux consommateurs
En 2000, la société GlaxoSmithKline a consacré 91,8 millions de dollars à la promotion du Paxil [Deroxat / Seroxat] aux États-Unis, soit presque 15 millions de plus que les sommes allouées par Nike à la promotion de ses chaussures de course. Ces dépenses ont porté fruit, puisque le chiffre de ventes de la société a augmenté de 355,6 millions de dollars entre 1999 et 200088.
Les dépenses consacrées à la publicité directe des médicaments d’ordonnance (PDMO) aux États-Unis sont passées de 26,6 millions de dollars en 199489 à plus de 3 milliards en 2003 90. Une telle hausse est largement attribuable à la publicité télédiffusée. (…) Selon des recherches, environ un tiers des personnes qui ont vu une publicité sur un médicament en parlent à leur médecin; entre 6 et 9 % d’entre eux demandent à leur médecin de leur prescrire ce médicament; et une grande majorité (80 %-84 %) le reçoivent. Les études de marché financées par les pharmaceutiques révèlent que le nombre de demandes soumises par des patients atteints de maladies ayant fait l’objet de campagnes de publicité directe a augmenté de façon spectaculaire91.
L’industrie pharmaceutique réagit promptement aux « occasions » créées par le « marché » en modifiant ses campagnes publicitaires. Marcia Angell donne l’exemple suivant : après que le traitement du trouble d’anxiété généralisée ait été approuvé, et peu après le 11 septembre 2001, la société GlaxoSmithKline a lancé une campagne ambitieuse sur l’utilisation du Paxil. « La pub montrait les tours du World Trade Centre en train de s’effondrer. Qui n’aurait pas été angoissé en voyant cela? Ce qui est sous-entendu, c’est qu’il faut traiter avec un médicament une émotion qui est tout à fait appropriée et temporaire dans la plupart des cas »92.
La promotion des ISRS par les groupes [associations] de patients et les groupes sans but lucratif
L’industrie pharmaceutique n’ignore pas que le public, (…) porte un regard sceptique sur la publicité [et que] les consommateurs (…) adhéreront davantage aux campagnes menées par une société pharmaceutique avec l’aval d’un organisme sans but lucratif [associations de malades et/ou groupes d’entraide, par exemple]. Ils croient aussi que les produits vendus ainsi ne présentent aucun danger et que les organismes sans but lucratif s’associent à ces campagnes en toute confiance93.
Les pharmaceutiques se servent délibérément des organismes sans but lucratif afin : 1) d’augmenter la vente de certains produits; 2) de redorer leur image de sociétés responsables; 3) de fidéliser les clients; 4) de faciliter la différenciation des produits; et 5) de favoriser la création de liens avec des consommateurs éventuels.
Les pharmaceutiques font souvent appel à des regroupements de patients ou à des groupes qu’elles créent spécifiquement afin de promouvoir directement ou indirectement les ISRS et d’autres médicaments. Elles financent ces groupes qui, à l’aide de « fonds de sensibilisation illimités », peuvent mieux faire connaître le « trouble » en question. Eli Lilly, le fabricant du Prozac, et 17 autres fabricants de psychotropes ont versé des millions de dollars à la National Alliance of the Mentally Ill (NAMI), le plus important regroupement de patients dans le secteur de la santé mentale aux États-Unis. Peu après, la NAMI reprenait haut et fort le slogan « la maladie mentale, c’est une maladie du cerveau » et réclamait une plus large gamme de traitements94. On demande souvent aux groupes de patients de mousser les ventes d’un produit en faisant la promotion d’un « trouble » et d’exercer des pressions sur les gouvernements et les compagnies d’assurance afin qu’ils ajoutent le traitement aux régimes d’assurance maladie95.
Et les patients sont aussi fréquemment sollicités. Comme l’explique Healy : « À la fin des années 90, l’industrie pharmaceutique faisait régulièrement appel à des patients pour promouvoir un nouvel antidépresseur, même lors de conférences médicales. Aux rencontres avec les médias, on accordait presque autant d’importance aux patients qu’aux médecins, parce qu’ils pouvaient expliquer, en termes simples, les bienfaits apportés par les antidépresseurs sur le fonctionnement du cerveau. Un message que peu de psychopharmacologues auraient aimé transmettre à l’époque »96.
L’inadéquation des mesures gouvernementales : un facteur contributif
L’inadéquation des mesures gouvernementales en matière de réglementation et de surveillance peut influer indirectement sur le taux élevé de prescriptions d’ISRS. Santé Canada n’exige pas, en effet, que les résultats des essais cliniques soient rendus publics. Dans le cas des ISRS, les résultats négatifs n’ont jamais été divulgués, ce qui donne au public et aux professionnels de la santé une image par trop rassurante de ce type de médicaments. (…) Il est impératif de se doter d’un mécanisme solide de surveillance, sinon la majorité des effets indésirables des médicaments ne seront pas signalés. On estime qu’à peine 1 % des médecins soumettent de telles déclarations relativement aux médicaments qu’ils prescrivent. Ainsi, jusqu’à octobre 1999, plus de 2 000 suicides associés au Prozac, un ISRS, avaient été enregistrés dans la base de données sur les effets indésirables de la FDA. Et l’organisme états-unien admet qu’il ne recueille qu’entre 1 % et 10 % des effets indésirables graves 97. »